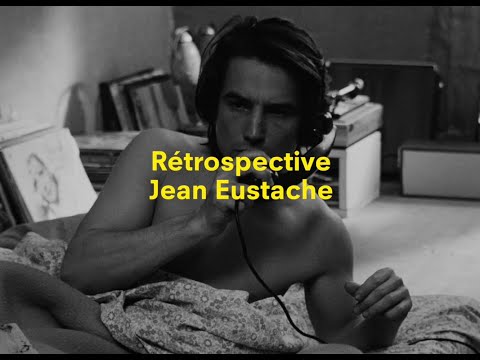Du 24 janvier au 28 février 2025, la Cinémathèque suisse consacre une rétrospective au cinéaste français Jean Eustache. Longs et courts métrages, documentaires, tous en version restaurée et numérisée avec la participation de la Cinémathèque suisse, composent cette oeuvre personnelle qui marqué l'histoire du cinéma après la Nouvelle Vague.
Redécouvrir Jean Eustache
Pendant longtemps, les films du cinéaste français Jean Eustache sont restés presque invisibles, dans des copies usées et abîmées par de multiples passages. Aujourd’hui, grâce à l’initiative de la légendaire société de production et de distribution Les Films du Losange – avec le soutien de la Cinémathèque suisse – tous ses films ont été restaurés en numérique et peuvent enfin faire l’objet d’une ressortie en salle, dans un coffret DVD édité par Carlotta et, enfin, au cinéma Capitole qui accueille cette œuvre dont l’intransigeance et la grâce ont marqué – et marquent encore – des générations de cinéphiles.
Né en 1938 à Pessac, près de Bordeaux, puis monté à Paris à l’âge de vingt ans, en pleine explosion cinéphilique, Jean Eustache fréquente les Cahiers du cinéma, la Cinémathèque française, et participe en 1962 au tournage du premier des Six contes moraux d’Eric Rohmer, La boulangère de Monceau. L’année suivante, il signe son premier moyen métrage, Les mauvaises fréquentations, dans le sillage des auteurs de la Nouvelle Vague. Puis, avec Le père Noël a les yeux bleus (1966), tourné grâce aux chutes de la pellicule de Masculin féminin (1966) de Jean-Luc Godard, Eustache commence à faire les films «que personne ne pourrait réaliser à sa place» (Serge Daney), en accordant au réel la primauté mais sans rien oublier du bonheur de la fiction.
Monteur pour des documentaires de télévision consacrés à Murnau et à Renoir (ses cinéastes de référence), Eustache continue de tourner: La Rosière de Pessac (1968), où il filme une fête traditionnelle de sa ville natale, Le Cochon (1970), qui restitue l’abattage et le découpage d’un cochon par des paysans, Numéro zéro (1970), dans lequel sa grand-mère lui raconte ses souvenirs d’enfance. Il est animé par une confiance absolue dans le pouvoir du cinéma «à faire du quotidien le plus quotidien une source perpétuelle d’événements émouvants, comiques, mystérieux» (Vincent Adatte).
La Maman et la Putain (Grand Prix spécial du Jury du Festival de Cannes 1973), qui réunit avec un naturel confondant toute la gamme des comportements humains, reste sans doute l’un des films les plus beaux du monde. Le succès critique et commercial du «premier chef-d’œuvre du cinéma vraiment parlant» (Godard) permet à Eustache de tourner Mes petites amoureuses (1974) où il chronique son adolescence passée à Narbonne. Mais l’échec relatif de ce film pourtant merveilleux l’oblige à renouer avec des tra- vaux précaires, restant fidèle à son désir de ne pas tourner à tout prix, quitte à en payer le prix: Une sale histoire (1977), «œuvre-clef sidérante et jubilatoire» (Jean-Michel Frodon), une deuxième Rosière de Pessac (1979), Le Jardin des délices (1980), analyse délirante du tableau de Bosch, Les Photos d’Alix (1980) dont le son et l’image ne vont pas forcément de pair, Offre d’emploi (1980), commentaire ironique de sa situation de cinéaste.
Le 5 novembre 1981, Eustache a refermé sa porte où, disait-il, il aurait tant aimé écrire: «Jean Eustache, cinéaste pour noces et banquets». Quelques jours après son suicide, le critique Serge Daney écrivait dans les colonnes de Libération: «De Jean Eustache, c’est peu dire qu’il était un auteur, son cinéma était impitoyablement personnel». A (re)découvrir d’urgence.
Frédéric Maire